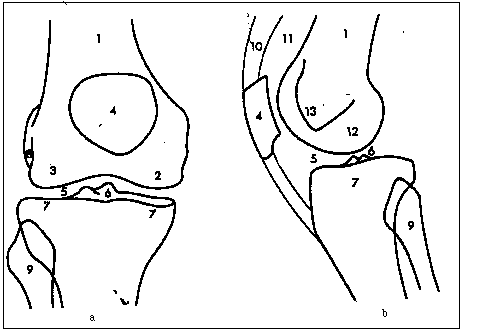
A. CHEVROT, N. CHEMLA, D. GODEFROY, AM DUPONT, B. VACHEROT, A. LANGER-CHERBIT
Hôpital Cochin - Paris
Le genou se subdivise en compartiments fémoro-tibiaux et fémoro-patellaires externe et interne.
Son anatomie complexe explique la diversité des incidences radiologiques standards.
Il faut enfiler l'interligne fémoro-tibial. Comme il est habituellement difficile d'enfiler sur le même cliché les interlignes interne et externe dont l'orientation et l'obliquité ne sont pas exactement identiques, on réalise un compromis en privilégiant le compartiment le plus intéressant (l'interne le plus souvent) (fig. 1).
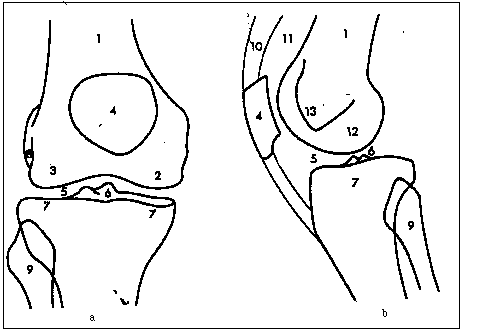
Figure 1 : Radiographie de genou face et profil. a) genou deface : 1. diaphyse fémorale ; 2. condyle interne ; 3. condyle externe 4. rotule ; 5. interligne fémoro-tibial : 6. épines tibiales ; 7. plateaux tibiaux ; 8. gouttière du tendon du muscle poplité ; 9. tête du péroné. b) genou de profil : 10. tendon du quadriceps ; 11. graisse sous-quadricipitale ; 12. condyles superposés ; 13. trochlée (parite antérieure du V fémoral).
Lorsque le genou est bien de face, les condyles sont bien symétriques et les épines tibiales sont au centre de l'échancrure.
L'incidence de face peut être réalisée de façon uni ou bilatérale sur un patient couché ou debout.
Le rayon directeur est incliné d'environ 10deg. vers la racine du membre pour superposer les deux condyles (fig. 1).
Cette incidence permet une analyse de l'articulation fémoro-tibiale, de l'articulation fémoro-patellaire entre face postérieure de la rotule et contour de la trochlée (V fémoral).
L'incidence axiale fémoro-patellaire bilatérale à 30, 60 et 90deg. de flexion du genou (le degré de flexion du genou est mesuré à partir de l'extension, qui représente la flexion à 0deg.), étudie les surfaces articulaires de la rotule et de la trochlée et l'interligne fémoro-patellaire (fig . 2).
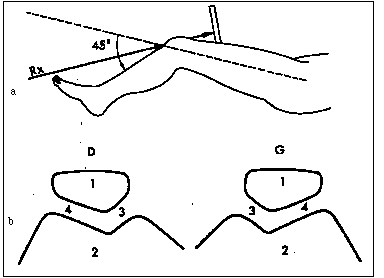
Figure 2 : Incidence axiale fémoro-patellaire. a) position du patient pour la réalisation de l'incidence fémoro-patellaire de 45deg. de flexion de genou. b) incidences fémoro-patellaires bilatérales : 1. rotule ; 2. trochlée ; 3. interligne fémoro-patellaire interne ; 4. interligne fémoro-patellaire externe. Les clichés sont pris à 30, 45, 60 et 90deg. de flexion du genou.
 1.4.
Gonométrie
1.4.
Gonométrie Radiographie de la totalité du membre inférieur depuis la hanche jusqu'à la cheville afin de déterminer une éventuelle désaxation en varus ou en valgus (genu varum ou genu valgum). Ces déviations sont calculées à partir des axes mécaniques. L'axe mécanique de la cuisse est l'axe joignant le centre de la tête fémorale au centre du genou. Pour la jambe, c'est la ligne joignant le centre du genou au centre de l'articulation tibio-tarsienne. Normalement ces deux axes sont alignés (fig. 3).
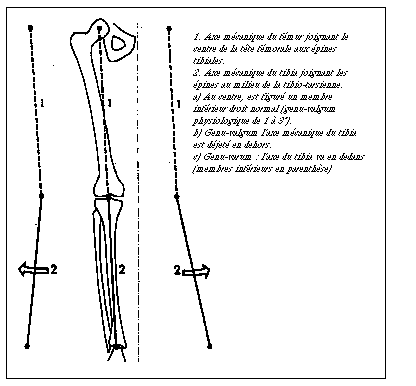
Figure 3 : Gonométrie : grand cliché en position debout.
 1.5. Autres incidences
1.5. Autres incidences
Échancrure inter-condylienne : permet d'étudier de face les corps étrangers et les calcifications de l'échancrure inter-condylienne et le contour de la face postérieure des condyles.
Incidence de trois-quart en rotation interne et externe: la rotation interne dégage le condyle externe et l'articulation péronéo-tibiale supérieure ; la rotation externe dégage le condyle interne.
Incidences en position forcée (valgus, varus, tiroir). : elles servent essentiellement à mettre en évidence des lésons ligamentaires ou capsulo-ligamentaires et sont toujours réalisées de façon bilatérale et comparative en raison de phénomènes de laxité physiologique.
 1.6. Arthrographie du genou
1.6. Arthrographie du genou
Grâce à l'injection à l'intérieur de la cavité articulaire du genou d'un produit de contraste radio-opaque, on peut étudier les différents éléments de la cavité articulaire (dimensions), une éventuelle communication avec d'autres cavités péri-articulaires (kyste poplité), l'épaisseur des cartilages articulaires, les ligaments croisés, surtout les ménisques avec une analyse particulière de la corne postérieure du ménisque interne et de la corne antérieure du ménisque externe qui sont de loin les régions les plus sujettes aux lésions traumatiques (fig. 4).
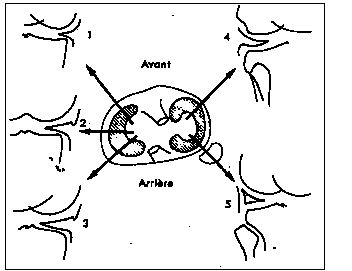
Figure 4 : Arthrographie du genou, image normale (d'après G.Pallardy). 1. Corne antérieure du ménisque interne ; 2. Portion moyenne du ménisque interne ; 3. Corne postérieure du ménisque interne ; 4. Corne antérieure du ménisque externe ; 5. Corne postérieure du ménisque externe. A noter le passage du tendon du muscle poplité.
C'est un excellent moyen d'étudier les ménisques, les ligaments, les cavités articulaires et les éléments squelettiques (fig. 5).
Elle tend à prendre la place de l'arthrographie et de la tomodensitométrie. Elle devrait arriver en première ligne des examens complémentaires non invasifs après la radiographie standard
Les fibro-cartilages ménisquaux, les ligaments, les tendons et les corticales ont un hypo-signal quelque soit la séquence et sa pondération.
La graisse est en hypo-signal sur les images pondérées en T1, signal qui diminue graduellement jusqu'à un signal intermédiaire quand la pondération en T2 augmente.
Le liquide est en hypo-signal en T1 et en hyper-signal en T2.
Le cartilage a un signal intermédiaire en T1 et un hyper-signal en T2.
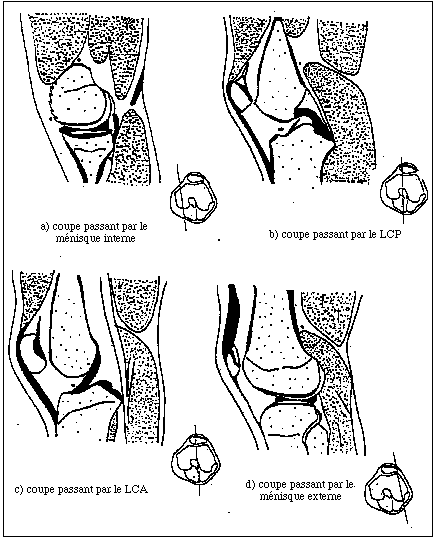
Figure 5 : IRM : coupes sagittales.
 2.1. Traumatismes du genou
2.1. Traumatismes du genou Face-profil, éventuellement incidence fémoropatellaire à 60deg. de flexion
Deux genoux de face sur le même cliché, en décubitus.
Incidence fémoro-patellaire à 30,60 et 90deg. de flexion.
Éventuellement autres incidences selon la topographie des lésions.
 2.3. Pathologie médico-chirurgicale : genu varum, genu valgum
désaxation et subluxation rotulienne
2.3. Pathologie médico-chirurgicale : genu varum, genu valgum
désaxation et subluxation rotulienne
Deux genoux de face sur le même cliché en charge.
Clichés de gonométrie
Incidence fémoro-patellaire à 30, 60, 90deg. avec et sans contraction quadricipitale
L'IRM tend à remplacer de plus en plus l'arthrographie dans la recherche des lésions méniscales.
 3.1. Traumatisme
3.1. Traumatisme Sans revenir sur les différents traits de fracture au niveau du fémur, du tibia ou de la rotule, il faut insister sur la signification particulière d'un épanchement intra-articulaire post-traumatique (hémarthrose) qui témoigne de l'existence d'une fracture intra-articulaire (fig. 6).
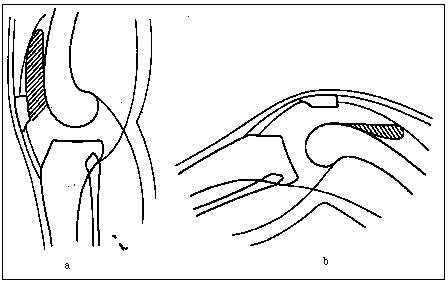
Figure 6 : Épanchement du genou. a) épanchement du genou : opacité siégeant dans l'espace clair sus-rotulien. b) rayon horizontal , un niveau liquide de lipo-hémarthrose affirme la fracture articulaire.
L'hémarthrose peut être le seul témoin de la fracture en cas de trait de fracture passé inaperçu.
L'épanchement est visible au niveau du cul-de-sac sous-quadricipital sous forme d'une opacité ovalaire occupant l'espace clair sus-rotulien, en avant de la diaphyse fémorale, en arrière du tendon du quadriceps.
La lipohémarthrose, visible sur le cliché de profil avec rayon horizontal, sous forme d'un niveau liquide identifie la fracture.
 3.2. Tumeurs du genou
3.2. Tumeurs du genou La plupart des tumeurs osseuses bénignes ont la particularité de se situer près du genou, dans un nombre très grand nombre de cas (règle classique : près du genou, loin du coude). Il en est ainsi de quelques tumeurs bénignes (fig. 7).
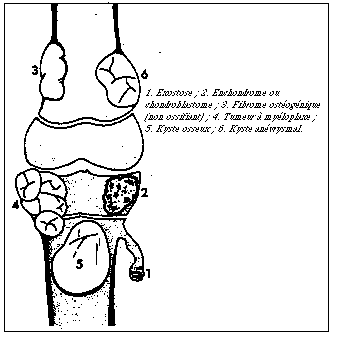
Figure 7 : Localisation de quelques tumeurs bénignes osseuses aux genoux.
Il en est de même de plusieurs tumeurs malignes notamment ostéosarcome et chondrosarcome (fig. 8).
L'IRM permet de faire un bilan précis des lésions tumorales et d'apprécier leurs rapports avec les articulations sus et sous-jacentes, indispensable avant toute éxérèse chirurgicale
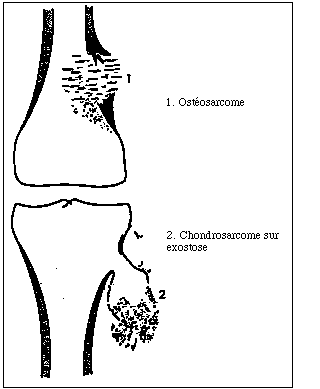
Figure 8 : Localisation de quelques tumeurs malignes aux genoux.
 3.3.
Dysplasies
3.3.
Dysplasies Plusieurs affections congénitales, héréditaires ou non peuvent se manifester par des anomalies squelettiques du genou, par des modifications de la forme ou de la structure osseuse : On ne retiendra que l'image en crochet du plateau tibial interne parfois hypoplasique et avec genu varum, en cas de syndrome de Turner (fig 9).
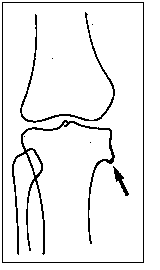
Figure 9 : Syndrome de Türner : image en corchet du plateau tibial interne.
 3.4. Arthrite du genou
3.4. Arthrite du genou
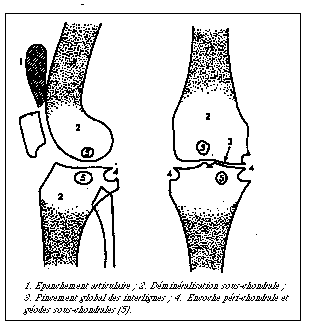
Figure 10 : Arthrite du genou
- les pincements globaux de l'interligne (fémoro-tibiaux et fémoro-patellaires).
- l'épanchement intra-articulaire.
- la déminéralisation sous-chondrale.
- l'existence d'encoches péri-chondrales et géodes sous-chondrales.
- soit une cause infectieuse (tuberculose ou autres germes)
- soit une cause inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde)
 3.5. Maladies métaboliques
: arthropathies micro-cristallines
3.5. Maladies métaboliques
: arthropathies micro-cristallines La goutte ne donne pas d'aspect particulier, en dehors de manifestations de type inflammatoire, mais sans les encoches ou les lacunes sous-chondrales (en dehors des tophus goutteux).
On retiendra surtout des manifestations radiologiques de la chondrocalcinose : liseré calcique péri-osseux au niveau des zones où se situe le cartilage d'ecroûtement, et calcifications ponctuées des formations méniscales. La chondrocalcinose, très fréquente chez la femme, surtout âgée, est particulière car elle peut entraîner ou favoriser une arthrose et spécialement, une arthrose fémoro-patellaire, destructrice (fig. 11).
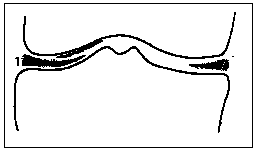
Figure 11 : Chondrocalcinose du genou. Calcifications méniscales
et liseré opaque intracartilagineux.
 3.6. L'arthrose du genou
3.6. L'arthrose du genou L'arthrose fémoro-patellaire est de loin la plus fréquente, quoique souvent méconnue parce que les radiographies en incidences fémoro-patellaires sont faites inconstamment.
Elle se manifeste par des douleurs du genou, et notamment des douleurs à la descente des escaliers et, à l'examen clinique, par une douleur provoquée à la palpation de la face postérieure de la rotule et un signe du rabot. Il peut exister un épanchement intra-articulaire de type mécanique (fig. 12).
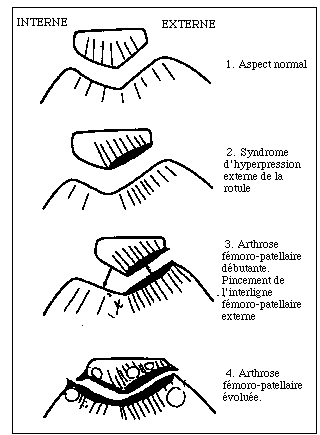
Figure 12 : Arthrose fémoro-patellaire.
Les radiographies sans préparation mettent en évidence des signes d'arthrose fémoro-patellaire qui prédominent le plus souvent sur le compartiment externe, même en l'absence de toute subluxation externe des rotules.
On aboutit tardivement à la disparition presque complète de l'interligne fémoro-patellaire avec ostéo-condensaton sous-chondrale et existence de géodes sous-chondrales (lacunes d'hyperpression), et de formations ostéophytiques périchondrales en forme de becs plus ou moins accentués.
Ces manifestations arthrosiques se rencontrent avec une fréquence bien plus grande, lorsque préexiste une désaxation rotulienne : subluxation externe des rotules, visibles sur les incidences fémoro-patellaires surtout dans les flexions faibles (30deg.), ou une dysphasie fémoro-patellaire.
L'arthrose fémoro-tibiale : révélée par des manifestations douloureuses de type mécanique, il peut s'agir soit d'arthrose centrée, sans désaxation dans le plan frontal, soit d'arthrose sur genu varum ou genu valgum. Elle se manifeste toujours par un pincement articulaire prédominant dans le sens de la désaxation, une ostéo-condensation sous-chondrale, avec des lacunes d'hyperpression sous-chondrale plus ou moins importantes, et une ostéophytose périphérique, parfois importante, et exubérante (fig 13).
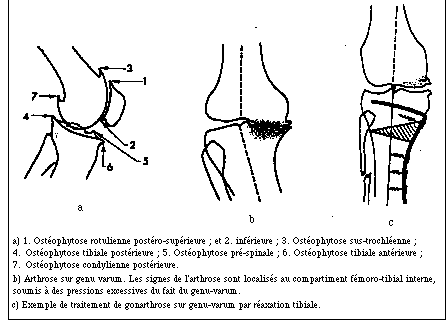
Figure 13 : Arthose du genou. Pincement articulaire.
Elle conduit plus ou moins vite à des interventions, soit de réaxation lorsque l'arhrose n'est pas trop avancée, soit de remplacement articulaire par les prothèses.
 3.7. Autres arthropathies
3.7. Autres arthropathies L'arthropathie hémophilique : elle survient chez le sujet jeune de sexe masculin, et se manifeste radiologiquement par des phénomènes arthrosiques et une augmentation de la taille des épiphyses.
Le tabès : la localisation aux genoux est l'une des plus fréquentes (tabès dorsalis), et elle se manifeste par des desructions importantes des surfaces articulaires avec des désaxations dans les deux plans, et des formations d'ostéochondromes exubérants à l'intérieur des cavités articulaires, même en l'absence de symptomatologie clinique.
 3.8. Autres pathologies du genou, radiologiquement visibles
3.8. Autres pathologies du genou, radiologiquement visibles
L'ostéochondromatose intra-articulaire : en présence d'ostéochondromes intra-articulaires, de taille variable, qui peuvent coéxister souvent avec des manifestations arthrosiques (fig. 14).
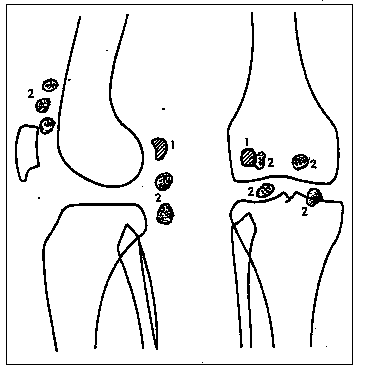
Figure 14 : ostéochondromatose intra-articulaire du genou. Le sésamoïde situé dans la coque du condyle externe (1. fabella) est à différencier d'ostéochondromes : corps étrangers intra-articulaires (2 ).
Luxation récidivante de la rotule : se voit chez la jeune fille. La rotule se positionne à la face externe du condyle externe (fig. 15).
L'algodystrophie : elle succède le plus souvent à un traumatisme ou une immobilisation.
Les douleurs sont de type inflammatoire.
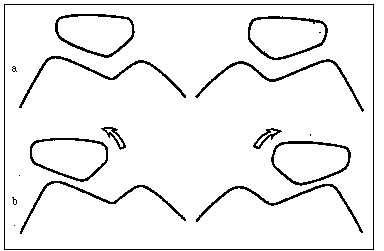
Figure 15 : Subluxation des rotules. a) Aspect normal à 30deg.. b) Aspect de subluxation des rotules à 30deg..
Les radiographies mettent en évidence une déminéralisation, visible seulement deux à trois semaines après le début de la clinique.
Cette déminéralisation est homogène, quelquefois hérétogène, tachetée. Les interlignes articulaires ne sont pas pincés.
 3.9. L'arthrite tumorale
3.9. L'arthrite tumorale La synovite villonodullaire est rare. Le genou représente la première localisation.
Elle est révélée par des douleurs de type inflammatoire évoluant par crises.
Les signes radiologiques sont pauvres : gros cul-de-sac quadricipital, lacunes périchondrales, notamment au niveau de la péronéo-tibiale supérieure lorsqu'elle est atteinte.
Le pincement de l'interligne articulaire est rare.
 3.10. Les maladies ischémiques
3.10. Les maladies ischémiques On regroupe sous ce terme l'ostéochondrose, l'ostéochondrite disséquente et l'ostéonécrose épîphysaire.
- L'ostéochondrose ou maladie d'Osgood-Schlatter. Elle touche plus souvent les garçons entre 10 et 15 ans
- L'ostéochondrite disséquante : touche le sujet jeune
La localisation préférentielle se fait sur le condyle interne, particulièrement dans la zone non portante de l'échancrure inter-condylienne.
Au début les signes sont très discret : minime bande de radio transparente. à concavité inférieure, petite zone hétérogène sous-chondrale arrondie ou ovalaire.
Au stade de séquestre, une ligne claire à concavité inférieure sépare du reste de l'os, le fragment nécrosé de densité variable.
Au stade de séquestre libre on retrouve la niche, qui se présente comme une perte de substance, bordée par une zone de condensation .
Le séquestre libre est le plus souvent retrouvé dans l'échancrure ou le cul-de-sac quadricipital. Il peut s'arrondir se fragmenter ou même disparaitre.
L'ostéonécrose aseptique : touche le plus souvent la femme âgée d'au moins 50 ans. Elle atteint le condyle interne dans 80% des cas. Le condyle est atteint en zone portante, contrairement à l'ostéochondrite disséquante. Elle siège à la partie moyenne et inférieure du condyle.
Les radiographies sont normales au début, les signes caractéristiques apparaissent plus tard comme :
- une image claire sous-chondrale en encoche
- une image en coquille d'oeuf
- une condensation péri-nécrotique
- une modification du contour condylien, mieux visible sur le profil.
La découverte d'un corps étranger est rare.
L'IRM met en évidence le séquestre cerné d'un liseré d'hypo-signal sur les séquences pondérées en T1 et en T2, typique d'ostéonécrose.
 3.11. La pathologie méniscale
3.11. La pathologie méniscale Syndrome méniscal clinique (blocage, dérobement, grinding-test positif).
l'Arthrographie permet de mettre en évidence la lésion sous forme d'une image d'addition de produit de contraste, bien visible sur les incidences déroulant le ménisque (fig. 16).
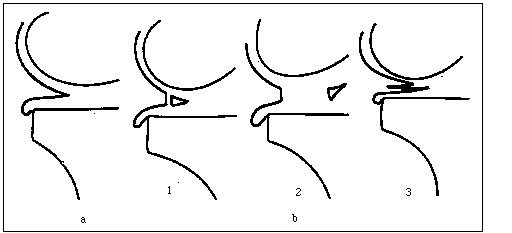
Figure 16 : Lésions méniscales. a) Aspect normal de la corne postérieure du ménisque interne. b) Exemple de lésions de la corne postérieure du ménisque interne : 1. fissure verticale ; 2. amputation avec anse de seau ; 3. fissure horizontale.
L'IRM tend à remplacer l'arthrographie, permettant de faire un bilan des lésions méniscales (hyper-signal en T1 et en T2, linéaire au sein du ménisque) et les lésions associées ostéoligamentaires.
 3.12. La pathologie péri-articulaire
3.12. La pathologie péri-articulaire Elle a habituellement peu de manifestations radiologiques (tendinite de la patte d'oie). On visualise parfois de petites calcifications des parties molles de la partie interne du condyle interne (traduisant un arrachement capsuloligamentaire traumatique ancien (Pelligrini-Stieda).
C'est un excellent examen pour mettre en évidence une rupture des ligaments croisés.
 4.
EN CONCLUSION
4.
EN CONCLUSION
 Transfert Word vers HTML par le Département d'Information Médicale
du CHRU de Pontchaillou Fev-95
Transfert Word vers HTML par le Département d'Information Médicale
du CHRU de Pontchaillou Fev-95